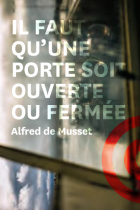Ses critiques
205 critiques
5/10
Difficile de résumer un spectacle lorsque la demande est expressément faite en fin de spectacle de ne rien dévoiler de l’intrigue et de ses rebondissements. Je pense qu’on me laissera au moins révéler la trame : un auteur à succès – en tout cas un auteur qui a écrit des succès – a du mal à se renouveler et tombe sous le charme d’un texte que lui envoie l’un de ses élèves. Difficile pour un auteur de thriller de ne pas céder à la tentation de faire disparaître le-dit élève et de s’approprier son travail…
Bon, bon, bon. J’avoue être un petit peu déçue parce que quand même, depuis le temps que la pièce se joue j’ai vu passer pas mal d’excellents avis sur la pièce. J’attendais un thriller prenant et j’ai eu une comédie. Après tout, pourquoi pas, rire ne peut pas faire de mal en ce moment. Mais le rire ne survient presque que lors des rebondissements. Entre chaque coup de théâtre, ce n’est pas exactement l’ennui mais plutôt un certain désintérêt devant une pièce qui s’emmêle et qui nous perdrait certainement sans la mise en scène et les acteurs.
Heureusement Eric Metayer parvient à nous maintenir à peu près en haleine grâce à sa mise en scène plutôt rythmée et dynamique. On retrouve également un Nicolas Briançon en bonne forme, parvenant à faire ressortir aisément les différentes facettes de son personnage – que je ne décrirai pas pour ne rien spoiler. J’avoue cependant que j’espère vite le retrouver dans des personnages plus intéressants. Marie Vincent campe une voyante plutôt délurée avec intelligence : elle tire en effet tout ce qu’elle peut de comique de ce personnage ingrat pouvant facilement tomber dans la surcaricature. Je suis en revanche plutôt déçue du personnage incarné par Virginie Lemoine, mal construit et plutôt dérangeant sur la scène : on ne comprend pas toujours son intérêt. Dommage.
Bon, bon, bon. J’avoue être un petit peu déçue parce que quand même, depuis le temps que la pièce se joue j’ai vu passer pas mal d’excellents avis sur la pièce. J’attendais un thriller prenant et j’ai eu une comédie. Après tout, pourquoi pas, rire ne peut pas faire de mal en ce moment. Mais le rire ne survient presque que lors des rebondissements. Entre chaque coup de théâtre, ce n’est pas exactement l’ennui mais plutôt un certain désintérêt devant une pièce qui s’emmêle et qui nous perdrait certainement sans la mise en scène et les acteurs.
Heureusement Eric Metayer parvient à nous maintenir à peu près en haleine grâce à sa mise en scène plutôt rythmée et dynamique. On retrouve également un Nicolas Briançon en bonne forme, parvenant à faire ressortir aisément les différentes facettes de son personnage – que je ne décrirai pas pour ne rien spoiler. J’avoue cependant que j’espère vite le retrouver dans des personnages plus intéressants. Marie Vincent campe une voyante plutôt délurée avec intelligence : elle tire en effet tout ce qu’elle peut de comique de ce personnage ingrat pouvant facilement tomber dans la surcaricature. Je suis en revanche plutôt déçue du personnage incarné par Virginie Lemoine, mal construit et plutôt dérangeant sur la scène : on ne comprend pas toujours son intérêt. Dommage.
5,5/10
Le Testament de Marie. Le spectacle est un seul en scène, l’affiche a quelque chose de très solennel. En haut, en ombres chinoises, Dominique Blanc transporte l’échelle dont on peut supposer qu’elle servira lors de la descente de croix du Christ. En dessous, c’est un gros plan sur le visage de l’actrice, les yeux levés vers le ciel, très digne, une larme sur la joue, qui laisse alors mon esprit vagabonder sur le spectacle que je vais voir. Pour moi le théâtre est un temple, et ce soir cette phrase va prendre tout son sens, car la scène aura quelque chose d’encore plus sacré. J’aurais peut-être mieux fait de lire un petit résumé avant…
En réalité, ce n’est pas une Marie convaincue, possédée, religieuse, qui nous est présentée. Le texte veut présenter une version bien plus rationnelle du mythe biblique, totalement terre-à-terre. Lors du début de la pièce, on comprend que Marie est appelée à témoigner sur la vie de son fils, mais elle répond qu’elle ne donnera pas le récit que les disciples du Christ attendent. Les grandes étapes qui accompagnent la vie de Jésus jusqu’à sa crucifixion sont totalement rationalisés : Lazare n’est pas ressuscité et les jarres des Noces de Cana étaient remplies de vin dès le départ. Amis rabats-joie du soir, bonsoir !
En fait, je crois que je n’étais pas disposée à recevoir ce genre de spectacle. Je me suis un peu sentie trahie, surtout après la scène d’ouverture du spectacle, qui promet une suite pleine de grandeur. En effet, c’est très particulier : lors de l’entrée dans la salle de l’Odéon, les spectateurs sont invités à se rendre sur scène pour se fondre dans le décor qui par la suite accueillera Marie. Elle est déjà là d’ailleurs, postée dans sa cage de verre, telle une statue dans son habit rouge et bleu. Le visage de Dominique Blanc a quelque chose de très majestueux à ce moment-là. On croit reconnaître en elle est des airs de la Marie qu’on est venu voir. Lorsqu’elle lève les yeux et croise mon regard entre admiration et méditation, elle me sourit, une chaleur m’envahit. La Grâce est là. Même si le reste du spectacle ne suit pas cette ligne initiale, je ne peux regretter d’avoir vécu ce moment suspendu.
Petit à petit, les spectateurs descendent de scène. Un écran se baisse pour cacher la partie sacrée de la scène et ne laisse aux spectateurs que la vision des éléments plus relatifs à l’homme qu’a été Jésus : une échelle, une éponge, une couronne d’épines, des chaises, une jarre, un seau… Le message passe rapidement : tout ici tend à nous présenter l’histoire à travers une banalité que nous avons trop souvent niée. Ce n’est pas ce que j’étais venue voir, et je m’avoue un peu déçue. D’autant que le texte montre très rapidement ses limites : il est très verbeux, et ne décolle pas. Certes, on cherche à s’éloigner d’une certaine forme de beauté. Mais rien n’empêche de raconter avec style la banalité.
Malgré tout, il faut bien reconnaître que Dominique Blanc fait dire à ce texte tout ce qui est possible. Évidemment, je l’aurais souhaitée plus possédée, plus passionnée, mais ce sujet qui l’entraîne à nous raconter une certaine forme de médiocrité ne peut laisser place à trop de grandeur. La scénographie même, qui l’agite autour de tâches du quotidien, tend à nous rappeler la platitude d’une vie ordinaire. Néanmoins, elle donne à cette Marie désacralisante une humanité parfois poignante, avec un crescendo net sur la fin de la pièce. Une belle incarnation.
En réalité, ce n’est pas une Marie convaincue, possédée, religieuse, qui nous est présentée. Le texte veut présenter une version bien plus rationnelle du mythe biblique, totalement terre-à-terre. Lors du début de la pièce, on comprend que Marie est appelée à témoigner sur la vie de son fils, mais elle répond qu’elle ne donnera pas le récit que les disciples du Christ attendent. Les grandes étapes qui accompagnent la vie de Jésus jusqu’à sa crucifixion sont totalement rationalisés : Lazare n’est pas ressuscité et les jarres des Noces de Cana étaient remplies de vin dès le départ. Amis rabats-joie du soir, bonsoir !
En fait, je crois que je n’étais pas disposée à recevoir ce genre de spectacle. Je me suis un peu sentie trahie, surtout après la scène d’ouverture du spectacle, qui promet une suite pleine de grandeur. En effet, c’est très particulier : lors de l’entrée dans la salle de l’Odéon, les spectateurs sont invités à se rendre sur scène pour se fondre dans le décor qui par la suite accueillera Marie. Elle est déjà là d’ailleurs, postée dans sa cage de verre, telle une statue dans son habit rouge et bleu. Le visage de Dominique Blanc a quelque chose de très majestueux à ce moment-là. On croit reconnaître en elle est des airs de la Marie qu’on est venu voir. Lorsqu’elle lève les yeux et croise mon regard entre admiration et méditation, elle me sourit, une chaleur m’envahit. La Grâce est là. Même si le reste du spectacle ne suit pas cette ligne initiale, je ne peux regretter d’avoir vécu ce moment suspendu.
Petit à petit, les spectateurs descendent de scène. Un écran se baisse pour cacher la partie sacrée de la scène et ne laisse aux spectateurs que la vision des éléments plus relatifs à l’homme qu’a été Jésus : une échelle, une éponge, une couronne d’épines, des chaises, une jarre, un seau… Le message passe rapidement : tout ici tend à nous présenter l’histoire à travers une banalité que nous avons trop souvent niée. Ce n’est pas ce que j’étais venue voir, et je m’avoue un peu déçue. D’autant que le texte montre très rapidement ses limites : il est très verbeux, et ne décolle pas. Certes, on cherche à s’éloigner d’une certaine forme de beauté. Mais rien n’empêche de raconter avec style la banalité.
Malgré tout, il faut bien reconnaître que Dominique Blanc fait dire à ce texte tout ce qui est possible. Évidemment, je l’aurais souhaitée plus possédée, plus passionnée, mais ce sujet qui l’entraîne à nous raconter une certaine forme de médiocrité ne peut laisser place à trop de grandeur. La scénographie même, qui l’agite autour de tâches du quotidien, tend à nous rappeler la platitude d’une vie ordinaire. Néanmoins, elle donne à cette Marie désacralisante une humanité parfois poignante, avec un crescendo net sur la fin de la pièce. Une belle incarnation.
5/10
Bajazet n’était initialement pas à l’affiche de la saison. C’est suite à « des difficultés insurmontables dans le montage de la production » (cf article du Monde à ce sujet) de La Cruche Cassée que devait mettre en scène Jacques Lassalle que, dans l’urgence, Eric Ruf décide de reprendre les rênes et de monter l’une des pièces les moins jouées de Racine – qui n’en reste pas moins sublime, il va sans dire. Quelle erreur ! Comment l’administrateur du Premier Théâtre de France a-t-il pu croire qu’il pouvait mettre en scène cette grande tragédie en quelques semaines seulement ? On ne monte pas Racine à l’arrache…
Déjà, ce n’est pas le Racine le plus simple qu’on puisse trouver. Bajazet, frère du sultan Amurat, est depuis longtemps enfermé par sa faute. Alors que le sultan siège à Babylone, il a confié le contrôle du sérail à sa favorite, Roxane. Celle-ci voudrait épouser Bajazet dont elle est tombée amoureuse, et lui propose l’hymen en échange du trône dont il a longtemps été écarté. Mais Bajazet aime Atalide et ne semble pas envisager l’engagement que lui propose la sultane – qui, bien sûr, n’est pas au courant de l’amour que se portent les deux jeunes amants.
J’ai essayé de résumer grossièrement l’intrigue de l’oeuvre. Grossièrement, c’est un peu l’adverbe qui me vient lorsque je repense au spectacle. C’est comme s’il avait simplement été dégrossi. Les acteurs semblent avoir travaillé les vers et leur diction, mais ne maîtrisent pas totalement leurs personnages. Quelques idées de mise en scène sont éparpillées ici ou là, mais aucune unité ne semble réellement se dégager. Au contraire, certaines idées semblent même faire contresens : que le suicide d’Atalide soit orchestré au moyen de lacets de chaussures est totalement ridicule. Ce n’est qu’une manière assez maladroite de justifier la présence de ces chaussures lors du premier acte de la pièce : cela permet à la mise en scène de retomber sur ses pieds – si vous me passez l’expression. Mais ça ne sert en rien le texte de Racine.
Les acteurs semblent un peu perdus. Pauvre Rebecca Marder, totalement écrasée par son rôle d’Atalide. La jeune comédienne n’a pas l’expérience ni les épaules pour porter un tel rôle. Elle parle bien trop vite, si bien qu’elle ne semble pas percevoir toujours le sens des vers qu’elle récite… et nous perd en même temps qu’elle. Elle crie trop, mais où est la douleur ? Où est la passion ? Crier ne sert à rien si l’âme n’y est pas. Ni les constants hochements de tête, qu’elle semble avoir adopté comme principale gestuelle. Léonie Simaga m’a beaucoup manqué, ce soir. Elle aurait fait une merveilleuse Atalide. Quand bien même, des actrices plus confirmées auraient pu donner du corps à ce rôle : je pense notamment à Suliane Brahim ou Georgia Scalliet… Aux côtés de la jeune comédienne, Clotilde de Bayser prouve sans effort sa plus longue expérience de la scène : les vers sont admirablement dits, les attitudes réfléchies et élégantes. Mais je découvre en Roxane un texte d’une cruauté monstrueuse, et la comédienne reste très en surface. Pourtant, j’aurais pu croire qu’elle avait la carrure pour incarner une grande Roxane.
J’aime beaucoup Laurent Natrella, mais comme ses camarades il a peine à se trouver une place sur la scène. Il faut dire que de base, Bajazet n’est pas le rôle sexy par excellence. Il est un peu insipide. Mais son arrivée en chemise de nuit n’était pas forcément la meilleure idée pour le mettre en valeur… Finalement, de toute la distribution, c’est Denis Podalydès qui s’en sort le mieux. Et c’est un euphémisme. Le comédien est magistral, dans ce rôle un peu ingrat du vieux politique qui reste en dehors des passions. Mais… mais ce n’est pas normal. Ce n’est pas normal que chez Racine, ce soit le personnage carré qui l’emporte ! Il devrait être le contrepoint, et se retrouve au centre. Mais où est la passion ? Où est l’émotion ? Bien loin du Vieux-Colombier, ce soir-là.
Déjà, ce n’est pas le Racine le plus simple qu’on puisse trouver. Bajazet, frère du sultan Amurat, est depuis longtemps enfermé par sa faute. Alors que le sultan siège à Babylone, il a confié le contrôle du sérail à sa favorite, Roxane. Celle-ci voudrait épouser Bajazet dont elle est tombée amoureuse, et lui propose l’hymen en échange du trône dont il a longtemps été écarté. Mais Bajazet aime Atalide et ne semble pas envisager l’engagement que lui propose la sultane – qui, bien sûr, n’est pas au courant de l’amour que se portent les deux jeunes amants.
J’ai essayé de résumer grossièrement l’intrigue de l’oeuvre. Grossièrement, c’est un peu l’adverbe qui me vient lorsque je repense au spectacle. C’est comme s’il avait simplement été dégrossi. Les acteurs semblent avoir travaillé les vers et leur diction, mais ne maîtrisent pas totalement leurs personnages. Quelques idées de mise en scène sont éparpillées ici ou là, mais aucune unité ne semble réellement se dégager. Au contraire, certaines idées semblent même faire contresens : que le suicide d’Atalide soit orchestré au moyen de lacets de chaussures est totalement ridicule. Ce n’est qu’une manière assez maladroite de justifier la présence de ces chaussures lors du premier acte de la pièce : cela permet à la mise en scène de retomber sur ses pieds – si vous me passez l’expression. Mais ça ne sert en rien le texte de Racine.
Les acteurs semblent un peu perdus. Pauvre Rebecca Marder, totalement écrasée par son rôle d’Atalide. La jeune comédienne n’a pas l’expérience ni les épaules pour porter un tel rôle. Elle parle bien trop vite, si bien qu’elle ne semble pas percevoir toujours le sens des vers qu’elle récite… et nous perd en même temps qu’elle. Elle crie trop, mais où est la douleur ? Où est la passion ? Crier ne sert à rien si l’âme n’y est pas. Ni les constants hochements de tête, qu’elle semble avoir adopté comme principale gestuelle. Léonie Simaga m’a beaucoup manqué, ce soir. Elle aurait fait une merveilleuse Atalide. Quand bien même, des actrices plus confirmées auraient pu donner du corps à ce rôle : je pense notamment à Suliane Brahim ou Georgia Scalliet… Aux côtés de la jeune comédienne, Clotilde de Bayser prouve sans effort sa plus longue expérience de la scène : les vers sont admirablement dits, les attitudes réfléchies et élégantes. Mais je découvre en Roxane un texte d’une cruauté monstrueuse, et la comédienne reste très en surface. Pourtant, j’aurais pu croire qu’elle avait la carrure pour incarner une grande Roxane.
J’aime beaucoup Laurent Natrella, mais comme ses camarades il a peine à se trouver une place sur la scène. Il faut dire que de base, Bajazet n’est pas le rôle sexy par excellence. Il est un peu insipide. Mais son arrivée en chemise de nuit n’était pas forcément la meilleure idée pour le mettre en valeur… Finalement, de toute la distribution, c’est Denis Podalydès qui s’en sort le mieux. Et c’est un euphémisme. Le comédien est magistral, dans ce rôle un peu ingrat du vieux politique qui reste en dehors des passions. Mais… mais ce n’est pas normal. Ce n’est pas normal que chez Racine, ce soit le personnage carré qui l’emporte ! Il devrait être le contrepoint, et se retrouve au centre. Mais où est la passion ? Où est l’émotion ? Bien loin du Vieux-Colombier, ce soir-là.
4/10
Voilà une pièce que je connais assez bien, et que j’aurais pu prendre beaucoup de plaisir à redécouvrir. Je l’ai vue plusieurs fois il y a plus de 5 ans maintenant, dans une mise en scène de Jean-Marie Besset au théâtre de l’Oeuvre. Le spectacle s’ouvrait sur un Musset, qui était suivi d’une pièce de Besset, Je ne veux pas me marier. Entre les deux pièces, les comparaisons affluaient : si le style était différent, les intentions, les sentiments, les tournures humaines étaient d’une proximité incroyable. J’aurais aimé retrouver ce soir la douceur et la poésie de cette courte pièce de Musset. Mais j’en sors les oreilles écorchées.
Musset nous entraîne dans un badinage galant : un Comte se rend chez une Marquise et lui fait la cour. Lorsqu’il lui déclare qu’il l’aime et ne pense qu’à elle depuis plus d’une année, elle se contente de lui rire au nez, se moquant de sa manière de faire la cour, si conventionnelle. A plusieurs reprises, le Comte, blessé, feint de partir mais chaque fois elle l’en empêche in extremis et les compliments, les flatteries, les déclarations reprennent, jusqu’à ce que la vérité éclate dans une fin toute en poésie.
C’est d’autant plus dur d’assister à la destruction d’un texte lorsque celui-ci est sublime. Mais ici, pas de quartier. A nouveau, Jennifer Decker produit ce que je redoutais le plus : incapable d’incarner la moindre émotion, elle surjoue tout au long du spectacle – ce qui est bien dommage puisqu’elle représente 50% de la distribution, et pratiquement 80% du texte. Incapable de s’accorder sur un style, elle tente tout : de la Marquise nunuche à la racaille vulgaire, j’aimerais pouvoir dire qu’elle cabotine mais cela sous-entendrait qu’elle a du métier. De son port jusqu’à ses répliques en passant par sa gestuelle, tout sonne faux, récité, appliqué.
Pauvre Musset. Et pauvre Christian Gonon. Incapable d’interpréter son rôle, elle va même jusqu’à écraser son partenaire de ses mouvements inutiles. Elle se regarde jouer et pas à un moment ne semble prendre conscience de lui… qui donne pourtant une jolie consistance à son personnage. On retrouve avec plaisir la poésie et la sensibilité de Musset, sa passion toute en finesse, ses évocations pleines de retenue. Je lui aurais souhaité une véritable partenaire… pour l’instant, je ne peux lui souhaiter que du courage.
Musset nous entraîne dans un badinage galant : un Comte se rend chez une Marquise et lui fait la cour. Lorsqu’il lui déclare qu’il l’aime et ne pense qu’à elle depuis plus d’une année, elle se contente de lui rire au nez, se moquant de sa manière de faire la cour, si conventionnelle. A plusieurs reprises, le Comte, blessé, feint de partir mais chaque fois elle l’en empêche in extremis et les compliments, les flatteries, les déclarations reprennent, jusqu’à ce que la vérité éclate dans une fin toute en poésie.
C’est d’autant plus dur d’assister à la destruction d’un texte lorsque celui-ci est sublime. Mais ici, pas de quartier. A nouveau, Jennifer Decker produit ce que je redoutais le plus : incapable d’incarner la moindre émotion, elle surjoue tout au long du spectacle – ce qui est bien dommage puisqu’elle représente 50% de la distribution, et pratiquement 80% du texte. Incapable de s’accorder sur un style, elle tente tout : de la Marquise nunuche à la racaille vulgaire, j’aimerais pouvoir dire qu’elle cabotine mais cela sous-entendrait qu’elle a du métier. De son port jusqu’à ses répliques en passant par sa gestuelle, tout sonne faux, récité, appliqué.
Pauvre Musset. Et pauvre Christian Gonon. Incapable d’interpréter son rôle, elle va même jusqu’à écraser son partenaire de ses mouvements inutiles. Elle se regarde jouer et pas à un moment ne semble prendre conscience de lui… qui donne pourtant une jolie consistance à son personnage. On retrouve avec plaisir la poésie et la sensibilité de Musset, sa passion toute en finesse, ses évocations pleines de retenue. Je lui aurais souhaité une véritable partenaire… pour l’instant, je ne peux lui souhaiter que du courage.
6,5/10
Je découvre en Tennesse Williams un auteur dont les thèmes abordés ne sont pas pour me déplaire. Dans Soudain, l’été dernier, il met en scène Violett, mère de Sebastien, décédé l’été précédent. Avant cette mort prématurée, ils étaient sans cesse collés l’un à l’autre, voyageant ensemble, elle se pensait essentielle dans l’inspiration de ce fils poète qu’elle chérissait. Elle ne cesse depuis de pleurer sa mort, et tient à faire interner sa nièce Catherine, seule témoin lors de sa mort, et qui invente des histoires abracadabrantes sur les circonstances de la disparition de Sebastien. Seulement, le médecin à qui elle présente Catherine en vue d’une lobotomie ne la trouve pas si folle, et fait en sorte d’arriver à arracher à la jeune fille le secret des circonstances de la mort de Sebastien.
Certes, je connais assez mal l’univers de Tennesse Williams. Je l’ai découvert à travers ce spectacle, et j’ai ressenti une profondeur, une tension, une étrangeté très particulière. On y trouve des images étonnantes au premier abord, des parallèles bien construits, une histoire qui parvient à tenir le spectateur en haleine. Une atmosphère somme toute assez pesante, et qui aurait eu encore plus à donner si elle n’avait pas été bridée par le metteur en scène. Je pense par exemple au jeu de Luce Mouchel. Si juste. Mais qui aurait pu être terrifiant, presque possédé. Elle semble avoir beaucoup plus à donner que ce que la direction d’acteur lui a dicté. Tous les acteurs semblent avoir peur des silences. La tension est créée par le texte, l’atmosphère aussi, mais la mise en scène reste trop superficielle pour toucher réellement. La folie gagne à être vécue, plus qu’à être jouée. De ce côté-là, malheureusement, je suis restée sur ma faim.
En effet, aux côtés de Luce Mouchel, les acteurs sont plutôt… composites. Je pense à Jean-Baptiste Anoumon, trop proche de son texte, qui ne parvient pas à décoller et campe un docteur trop peu réactif aux assertions de ses malades. Étonnée de constater comme certaines des répliques de Luce Mouchel pouvaient créer si peu de réaction chez lui, et comme son ton restait si monotone au fil des discussions… Néanmoins il faut souligner qu’il clôture le spectacle avec brio. Étonnée également comme Marie Rémond amène son histoire finale. Ce devrait être l’acmé du spectacle. Mais ça s’essouffle car l’histoire est apprise, elle est récitée, on ne la voit pas dans ses yeux… En revanche, les rôles plus secondaires sont parfaitement assurés par Glenn Marausse, Océane Cairaty, Virginie Colemyn, Boutaïna El Fekkak, qui évoluent chacun autour d’un trait particulier de leur personnage, jurant avec la folie complexe et hétérogènes des personnages principales.
Pourtant, il y a de très beaux moments. De manière générale, le décor est magnifique, tout autant que les lumières, qui guident le spectacle. De même, la scène initiale, où ce rideau de douche étrange qui créait le 4e mur se décore soudainement de rouge, nous faisant progressivement rentrer dans cette chimère qu’est la réalité proposée par Tennesse Williams. Il arrive à faire percevoir les aspects quelque peu mystiques, étranges et inhabituels des situations qui sont jouées sous nos yeux. Mais je trouve qu’il rate la tension, la profondeur, la folie.
Certes, je connais assez mal l’univers de Tennesse Williams. Je l’ai découvert à travers ce spectacle, et j’ai ressenti une profondeur, une tension, une étrangeté très particulière. On y trouve des images étonnantes au premier abord, des parallèles bien construits, une histoire qui parvient à tenir le spectateur en haleine. Une atmosphère somme toute assez pesante, et qui aurait eu encore plus à donner si elle n’avait pas été bridée par le metteur en scène. Je pense par exemple au jeu de Luce Mouchel. Si juste. Mais qui aurait pu être terrifiant, presque possédé. Elle semble avoir beaucoup plus à donner que ce que la direction d’acteur lui a dicté. Tous les acteurs semblent avoir peur des silences. La tension est créée par le texte, l’atmosphère aussi, mais la mise en scène reste trop superficielle pour toucher réellement. La folie gagne à être vécue, plus qu’à être jouée. De ce côté-là, malheureusement, je suis restée sur ma faim.
En effet, aux côtés de Luce Mouchel, les acteurs sont plutôt… composites. Je pense à Jean-Baptiste Anoumon, trop proche de son texte, qui ne parvient pas à décoller et campe un docteur trop peu réactif aux assertions de ses malades. Étonnée de constater comme certaines des répliques de Luce Mouchel pouvaient créer si peu de réaction chez lui, et comme son ton restait si monotone au fil des discussions… Néanmoins il faut souligner qu’il clôture le spectacle avec brio. Étonnée également comme Marie Rémond amène son histoire finale. Ce devrait être l’acmé du spectacle. Mais ça s’essouffle car l’histoire est apprise, elle est récitée, on ne la voit pas dans ses yeux… En revanche, les rôles plus secondaires sont parfaitement assurés par Glenn Marausse, Océane Cairaty, Virginie Colemyn, Boutaïna El Fekkak, qui évoluent chacun autour d’un trait particulier de leur personnage, jurant avec la folie complexe et hétérogènes des personnages principales.
Pourtant, il y a de très beaux moments. De manière générale, le décor est magnifique, tout autant que les lumières, qui guident le spectacle. De même, la scène initiale, où ce rideau de douche étrange qui créait le 4e mur se décore soudainement de rouge, nous faisant progressivement rentrer dans cette chimère qu’est la réalité proposée par Tennesse Williams. Il arrive à faire percevoir les aspects quelque peu mystiques, étranges et inhabituels des situations qui sont jouées sous nos yeux. Mais je trouve qu’il rate la tension, la profondeur, la folie.