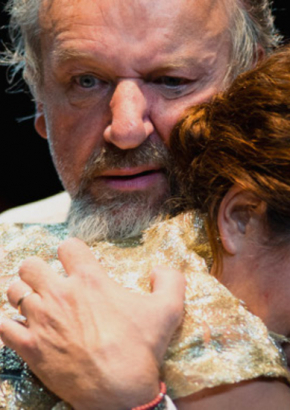Son balcon
SAISON 2025-2026
Aucun challenge culturel pour le moment
Mini Molières
137reçus
Amatrice de théâtre
Son classement : 496 / 6202
Avant elle
Clouche -
2 critiques
Après elle
Elodie Parisienne
2 critiques
Niveau
2 / 20
2 / 20
2
critiques
filatures
2
2
Espions
Derniers curieux qui ont visité son profil
Actualités de ses filatures
Ceci est le troisième opus de la vie d’Élise. Je l’avais découverte il y a sept ans à l’Espace Saint-Martial dans le Off d’Avignon avec le premier volet de cette oeuvre autobiographique : « La banane américaine ». Il y eut d’abord son enfance, puis son adolescence (« Pour que tu m’aimes encore » que j’avais raté) et maintenant le passage à l’âge adulte. Elise Noiraud m’avait déjà à l’époque séduit, le genre « monologue autofictionnel » étant l’une de mes passions.
Ici, l’artiste ne fait que confirmer le bien que je pensais. L’écriture est simple et directe, la mise en scène toute aussi sobre (une chaise, un coffre, des changements de lumière, des musiques bien choisies (oui, j’ai eu aussi ma période All Saints avec « Pure Shores ») et surtout il y a une sacrée comédienne devant nous.
Si on devait faire des rapprochements, on pourrait dire qu’il y a du Philippe Caubère chez Elise Noiraud, cette façon de passer d’un personnage à l’autre, de caractériser cette mère omniprésente, toxique… « Le Champ des possibles » est d’ailleurs plus profond qu’il n’y parait. Sous des allures de « seule en scène » comique, viennent poindre progressivement des instants dramatiques, sur l’accomplissement de soi, sa place quand on devient adulte.
Le rythme y est soutenu. J’aime cette idée de se raconter par le regard d’autres personnages.
Cette pièce est réussie parce qu’Elise Noiraud parle d’elle-même. Elle nous cueille surtout quand elle se joue elle-même. Cette pièce est réussie, surtout parce que chacun s’y reconnait. Je m’y suis reconnu : l’arrivée à Paris (même si j’étais sensiblement plus vieux), le rapport à la famille, l’éloignement géographique…
Je suis Élise. (et je jette au sol mon micro)
Ici, l’artiste ne fait que confirmer le bien que je pensais. L’écriture est simple et directe, la mise en scène toute aussi sobre (une chaise, un coffre, des changements de lumière, des musiques bien choisies (oui, j’ai eu aussi ma période All Saints avec « Pure Shores ») et surtout il y a une sacrée comédienne devant nous.
Si on devait faire des rapprochements, on pourrait dire qu’il y a du Philippe Caubère chez Elise Noiraud, cette façon de passer d’un personnage à l’autre, de caractériser cette mère omniprésente, toxique… « Le Champ des possibles » est d’ailleurs plus profond qu’il n’y parait. Sous des allures de « seule en scène » comique, viennent poindre progressivement des instants dramatiques, sur l’accomplissement de soi, sa place quand on devient adulte.
Le rythme y est soutenu. J’aime cette idée de se raconter par le regard d’autres personnages.
Cette pièce est réussie parce qu’Elise Noiraud parle d’elle-même. Elle nous cueille surtout quand elle se joue elle-même. Cette pièce est réussie, surtout parce que chacun s’y reconnait. Je m’y suis reconnu : l’arrivée à Paris (même si j’étais sensiblement plus vieux), le rapport à la famille, l’éloignement géographique…
Je suis Élise. (et je jette au sol mon micro)
Je pense n’avoir jamais vu/lu de pièces de Copi*. Et pour être honnête, je n’ai aucune idée du personnage qu’il était, même si j’ai cru comprendre qu’il était quelqu’un de singulier.
Je ne pouvais pas mieux tomber en voyant donc se confronter l’univers de Copi et celui de Stéphanie Aflalo aux avant-postes et de Florian Pautasso aux manettes. La comédienne est un drôle d’animal qui sait jouer de son visage, de son corps, de sa diction, tant et si bien qu’on reste fasciné par ce qu’elle dégage durant cette heure où elle est seule en scène. Dans l’espace familier du bureau, elle nous emmène à des années lumière de la stratosphère pour un moment théâtral qui ne ressemble à rien de ce que l’on a pu voir jusqu’à présent. Il n’est pas étonnant de constater qu’il n’y a presque aucun travail sur la lumière ou le son. Tout repose sur les épaules de Stéphanie Aflalo qui enchaine à une vitesse folle les phrases absurdes de Copi.
Cette Loretta Strong est bien un objet théâtral non identifié, à la langue et au corps qui déconcerteront certains, mais qui est assurément une découverte (de 1974, je sais…)
*après verification, oui : Les Quatre Jumelles par Jean-Michel Rabeux au Théâtre de la Bastille en 2012
Je ne pouvais pas mieux tomber en voyant donc se confronter l’univers de Copi et celui de Stéphanie Aflalo aux avant-postes et de Florian Pautasso aux manettes. La comédienne est un drôle d’animal qui sait jouer de son visage, de son corps, de sa diction, tant et si bien qu’on reste fasciné par ce qu’elle dégage durant cette heure où elle est seule en scène. Dans l’espace familier du bureau, elle nous emmène à des années lumière de la stratosphère pour un moment théâtral qui ne ressemble à rien de ce que l’on a pu voir jusqu’à présent. Il n’est pas étonnant de constater qu’il n’y a presque aucun travail sur la lumière ou le son. Tout repose sur les épaules de Stéphanie Aflalo qui enchaine à une vitesse folle les phrases absurdes de Copi.
Cette Loretta Strong est bien un objet théâtral non identifié, à la langue et au corps qui déconcerteront certains, mais qui est assurément une découverte (de 1974, je sais…)
*après verification, oui : Les Quatre Jumelles par Jean-Michel Rabeux au Théâtre de la Bastille en 2012
Je mentirais si je disais que je suis un spécialiste de Jan Fabre. J’ai seulement vu quatre de ses spectacles, pourtant je ne peux m’empêcher de penser que Jan Fabre nous a concocté ici un « Belgium Rules, Belgian Rules » proche d’un Mount Olympus light. (Pour rappel, Mount Olympus était une performance de 24h...)
Jan Fabre teste toujours autant la résistance de ses artistes que celle des spectateurs : nombre d’entre nous ont quitté la salle tout au long de la performance (3h45 sans entracte sur les banquettes de la Villette, ça fait mal au cucul à la longue ou bien est-ce moi qui suis devenu particulièrement douillet). On a également retrouvé ces scènes où les danseurs scandent ces fameuses règles en exécutant en boucle des exercices de musculation (variante de la corde à sauter dans Mount Olympus) : et ça dure… et ça dure… (« oh, qu’ils sont résistants, oh c’est touchant, ils se donnent vraiment à fond ! »… mais c’est alors qu’on crie « Déjà-Vou »)
Certaines scènes ont également pour objectif de tester notre sens olfactif : encens et bière à gogo (si je devais faire du mauvais esprit, je dirais que c’était de la Tourtel et non une bière d’abbaye).
Alors oui, il y a des tableaux très beaux, hypnotiques même, comme celui des drapeaux (je me suis souvenu qu’en CM2, j’avais participé à la Fête du Stade : c’était au Stade Vélodrome de Marseille et les écoles participantes devaient exécuter une chorégraphie sur une musique de Jean-Michel Jarre. Nous avions chacun deux drapeaux que nous faisions virevolter, tournoyer…). On voit des danseur.ses légèrement vêtu.es (surtout les filles… tiens donc… je ne vais pas me plaindre, hein… mais quand on y pense… je dirais même, quand on y réfléchit…), on y fait gicler la bière, on retrouve ces scènes durant lesquelles les danseur.ses font de la muscu, une dame qui fait pipi… Les passages parlés sont les moins intéressants. Ceci étant dit, les numéros collectifs sont toujours aussi enthousiasmants (avec du Stromae, du Jacques Brel, de la techno style pompier et du Adamo en fond sonore) et parfaitement exécutés.
Pour résumer, dans cette "histoire historique" et culturelle de la Belgique qui oscille entre amour et haine du plat pays, qui n’hésite pas non plus à égratigner sa politique colonialiste (comme tant d’autres), Jan Fabre fait ce qu’on attend de lui et ce n’est pas suffisant, pour moi en tout cas.
(Et je suis curieux de savoir ce qu’en pensent les Belges… Les applaudissements furent plutôt mous hier soir par chez nous…)
Jan Fabre teste toujours autant la résistance de ses artistes que celle des spectateurs : nombre d’entre nous ont quitté la salle tout au long de la performance (3h45 sans entracte sur les banquettes de la Villette, ça fait mal au cucul à la longue ou bien est-ce moi qui suis devenu particulièrement douillet). On a également retrouvé ces scènes où les danseurs scandent ces fameuses règles en exécutant en boucle des exercices de musculation (variante de la corde à sauter dans Mount Olympus) : et ça dure… et ça dure… (« oh, qu’ils sont résistants, oh c’est touchant, ils se donnent vraiment à fond ! »… mais c’est alors qu’on crie « Déjà-Vou »)
Certaines scènes ont également pour objectif de tester notre sens olfactif : encens et bière à gogo (si je devais faire du mauvais esprit, je dirais que c’était de la Tourtel et non une bière d’abbaye).
Alors oui, il y a des tableaux très beaux, hypnotiques même, comme celui des drapeaux (je me suis souvenu qu’en CM2, j’avais participé à la Fête du Stade : c’était au Stade Vélodrome de Marseille et les écoles participantes devaient exécuter une chorégraphie sur une musique de Jean-Michel Jarre. Nous avions chacun deux drapeaux que nous faisions virevolter, tournoyer…). On voit des danseur.ses légèrement vêtu.es (surtout les filles… tiens donc… je ne vais pas me plaindre, hein… mais quand on y pense… je dirais même, quand on y réfléchit…), on y fait gicler la bière, on retrouve ces scènes durant lesquelles les danseur.ses font de la muscu, une dame qui fait pipi… Les passages parlés sont les moins intéressants. Ceci étant dit, les numéros collectifs sont toujours aussi enthousiasmants (avec du Stromae, du Jacques Brel, de la techno style pompier et du Adamo en fond sonore) et parfaitement exécutés.
Pour résumer, dans cette "histoire historique" et culturelle de la Belgique qui oscille entre amour et haine du plat pays, qui n’hésite pas non plus à égratigner sa politique colonialiste (comme tant d’autres), Jan Fabre fait ce qu’on attend de lui et ce n’est pas suffisant, pour moi en tout cas.
(Et je suis curieux de savoir ce qu’en pensent les Belges… Les applaudissements furent plutôt mous hier soir par chez nous…)
J’ai vu tous les films de Lars Von Trier. Il m’a parfois agacé (Antichrist), ébloui (Melancholia), bouleversé (Breaking the Waves), fasciné (L’hôpital et ses fantômes) mais je ne peux pas dire que le film « Le Direktør » m’ait laissé un souvenir impérissable, même si je me souvenais de l’argument principal.
Oscar Gómez Mata laisse libre court à la folie de sa troupe, Pierre Banderet en tête, qui interprète un faux directeur de tout, adepte des préceptes du fameux (et fictif) dramaturge Gambini (et que je fus heureux de revoir après une autre adaptation cinématographique, celle de la Maman et la Putain, version Dorian Rossel). Oui, c’est drôle, c’est parfois idiot (clin d’oeil), les comédiens jouent face au public par le truchement d’adresses directes, pour nous faire comprendre que l’entreprise et le théâtre ne sont pas si éloignés.
Je regarde ma montre. Une heure est passée. Nous sommes à mi-chemin. C’est là que le bât blesse, car la machine va tourner à vide. Les scènes s’éternisent, certains comédiens sont en roue libre (notamment dans les « passages méta-théâtraux », quand Christian Geffroy Schlittler (Ravn, le vrai directeur) devance la critique en avouant que c’est trop long ou quand il « affiche » à deux reprises un spectateur endormi au premier rang.). La pièce aurait gagné à être resserrée.
Et surtout en lisant la note d’intention après la pièce, je me suis demandé si je n’étais pas passé à côté de quelque chose de plus sérieux ou dénonciateur, là où je n’ai vu qu’une farce.
En résumé, j’ai beaucoup ri à la vision de cette pièce (j’avoue une fascination pour Camille Mermet qui interprète une Heidi A. lunaire et hypersensible), mais un peu vaine.
Oscar Gómez Mata laisse libre court à la folie de sa troupe, Pierre Banderet en tête, qui interprète un faux directeur de tout, adepte des préceptes du fameux (et fictif) dramaturge Gambini (et que je fus heureux de revoir après une autre adaptation cinématographique, celle de la Maman et la Putain, version Dorian Rossel). Oui, c’est drôle, c’est parfois idiot (clin d’oeil), les comédiens jouent face au public par le truchement d’adresses directes, pour nous faire comprendre que l’entreprise et le théâtre ne sont pas si éloignés.
Je regarde ma montre. Une heure est passée. Nous sommes à mi-chemin. C’est là que le bât blesse, car la machine va tourner à vide. Les scènes s’éternisent, certains comédiens sont en roue libre (notamment dans les « passages méta-théâtraux », quand Christian Geffroy Schlittler (Ravn, le vrai directeur) devance la critique en avouant que c’est trop long ou quand il « affiche » à deux reprises un spectateur endormi au premier rang.). La pièce aurait gagné à être resserrée.
Et surtout en lisant la note d’intention après la pièce, je me suis demandé si je n’étais pas passé à côté de quelque chose de plus sérieux ou dénonciateur, là où je n’ai vu qu’une farce.
En résumé, j’ai beaucoup ri à la vision de cette pièce (j’avoue une fascination pour Camille Mermet qui interprète une Heidi A. lunaire et hypersensible), mais un peu vaine.